Pourquoi les profs de langues dans l’enseignement supérieur ont-ils le blues ?
Contrats précaires, impression d’être la cinquième roue du carrosse dans nombre de filières, et, depuis l’an passé, marasme des échanges internationaux. Nombre d’enseignants en langues officiant dans le supérieur en ont gros sur le cœur. Zoom sur cette profession méconnue.

Les enseignants en langues dans les établissements du supérieur connaissent certaines difficultés spécifiques, mais avec de fortes inégalités en fonction de leurs lieux d’enseignement et surtout de leur statut.
Concentration inédite de contrats précaires
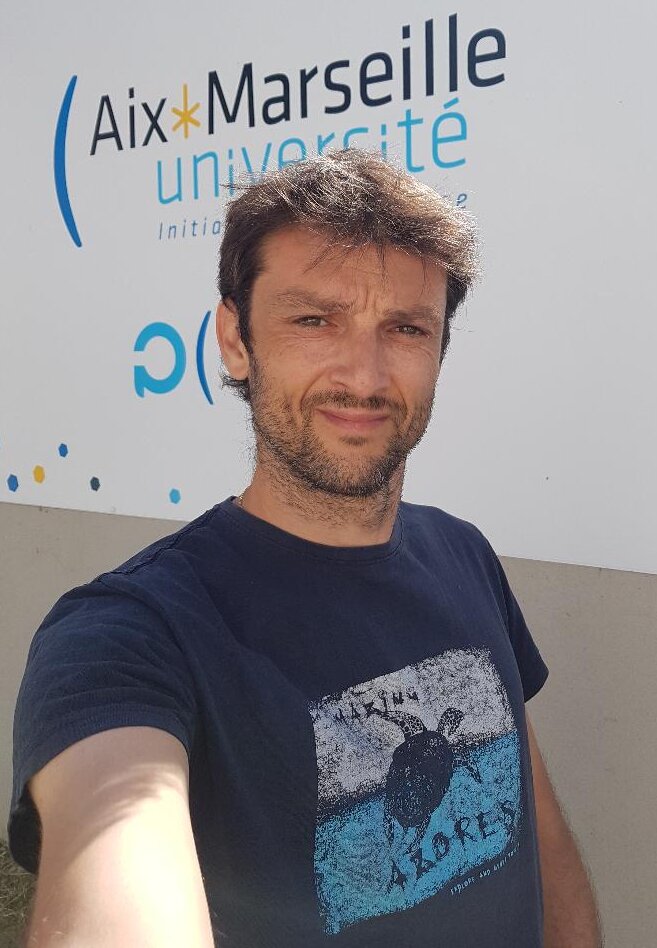
En 2018‐2019, les enseignants en langues constituaient le corps le plus précaire après le bloc droit-éco-gestion. Ce sont les centres de langues, rattachés à chaque université, qui concentrent un nombre élevé d’enseignants non permanents.
« C’est compliqué de dégager des postes de permanents dans ces disciplines, décrypte Jean-Laurent Gardarein, membre du Syndicat national du personnel technique de l’enseignement supérieur et de la recherche (SNPTES). Lorsqu’une composante décide de prendre un professeur agrégé (Prag) en anglais, cela équivaut pour les laboratoires de recherche associés à se passer de deux postes de maîtres de conférences en sciences et techniques. C’est souvent une décision difficile à prendre. »
Une situation précaire même dans les départements de langues
Si les langues sont le parent pauvre des filières scientifiques, la situation n’est guère plus reluisante dans celles dont c’est la discipline phare. Notamment pour les langues rares.

« Dans le département de chinois à l’UPVJ, on compte deux enseignants-chercheurs (E-C), un Prag, un lecteur, une contractuelle sur un poste de Prag et une vacataire. Soit six enseignants pour 200 étudiants, de la L1 au M2 », compte Georges Bê Duc, doyen de la faculté de langues de l’Université Picardie Jules Verne.
« Le chinois n’est enseigné comme enseignement de spécialité que dans la formation LEA, et ne compte que pour un tiers du programme : les deux autres tiers étant l’anglais et des matières tertiaires, non linguistiques », précise le maître de conférences (MCF) en langues et littérature chinoises de l’université amiénoise.
Des réalités différentes en fonction des statuts
Le doyen de la faculté de langues tient à relativiser la précarité qui « ne touche pas plus les enseignants et E-C en langue que des autres disciplines ».
« Comme ailleurs, la précarité touche surtout les non titulaires en général. Les candidats sont de plus en plus nombreux, avec des CV de plus en plus brillants. Ils doivent enchaîner pendant des années des contrats sans aucune garantie. Il y a au moins une cinquantaine de candidats en moyenne pour un poste de MCF », souligne Georges Bê Duc.
Aux premiers rangs de ces précaires, dans les sections linguistiques : les lecteurs et maîtres de langues, des natives* a priori, dont le contrat peut être dénoncé au bout d’un an. Selon le ministère, ils constituent 36 % des enseignants non permanents en langues et littérature (contre 22 % de contractuels L 954-3, 19 % de doctorants contractuels, 17 % d’Ater et 3 % d’enseignants invités/associés). Sans oublier les nombreux vacataires.
Les situations sont toutefois très différentes entre ces profils dénués de statut et les enseignants du second degré qui font des heures supplémentaires. « Pour ces derniers, les vacations, c’est simplement, le beurre dans les épinards », estime Jeanny Prat, formatrice en anglais et en didactique des langues-cultures étrangères à l'Inspé de l’académie de Lyon. Les réalités sont également très variables selon les universités et écoles, en fonction de leurs politiques RH, de leurs besoins et de leurs moyens.
Les langues, parents pauvres de nombre de filières
Une dispersion géographique
Les enseignants en langues se heurtent, par ailleurs, à un problème d’identité, voire de légitimité. « Leurs disciplines sont multisites par essence, car touchant à diverses écoles doctorales, réparties un peu partout dans les établissements. Une dispersion qui entraîne un manque d’émulation, des enseignants comme des étudiants », explique Jeanny Prat.
Parfois un manque d’intérêt des étudiants
Il faut dire que les langues n’ont pas toujours la cote dans nombre de filières, notamment scientifiques, où les élèves ont d’autres priorités. Dans les écoles d’ingénieurs, les cours d’anglais consistent parfois essentiellement à faire passer le Toeic (Test of english for international communication) aux étudiants. D’où un quotidien un peu rébarbatif, avant tout basé sur le bachotage, qui met les enseignants dans une position un peu inconfortable.
Des profils insuffisamment adaptés aux besoins des filières
Les professeurs de langues sont d’autant plus fragilisés que la pénurie de postes peut entraîner le recrutement de profils insuffisamment adaptés aux besoins des filières. « Chaque année, fin septembre-début octobre, puis fin janvier-début février, c’est la « course aux vacataires », témoigne Jeanny Prat, également vice-présidente de l’Association des professeurs de langues vivantes de l’enseignement public.

Certaines personnes sont embauchées précipitamment pour prendre en charge tel ou tel groupe d’étudiants, sans avoir été formés aux besoins spécifiques du cursus. Ou bien, on abandonne, purement et simplement.
« On n’ouvre un groupe de langues qu’à partir de 12 étudiants, car ce n’est pas rentable en deçà. Du coup, en langues, il est difficile d’avoir autre chose que de l’anglais, et a fortiori la possibilité pour les étudiants de choisir une 2e langue », évoque Jeanny Prat.
Ce qui peut amener à de véritables trous béants dans les plannings. « Par exemple, à Lyon 1, il n’y a pas eu de cours de langue étrangère pendant des années en licence Staps, du fait du manque de ressources humaines pour les langues, sur postes ou en vacataires », déplore-t-elle.
Les langues rares ou en déclin encore plus sur la sellette
Si tout n’est pas rose, l’anglais conserve la part belle par rapport aux autres langues. « En plus d’être la langue des pays de culture anglophones, c’est aussi la langue internationale incontournable dans toutes les filières », pointe Georges Bê Duc.
D’autres langues ont un effectif stable (espagnol) ou variable (chinois), d’autres, comme l’allemand, sont en recul sensible depuis plusieurs années. De quoi se poser la question, dans certains établissements, du maintien de leurs enseignements…
« Dans les facs de sciences en particulier, cela en devient presque même discriminatoire, explique cette enseignante en FLE qui souhaite rester anonyme. Comme les chercheurs sont obligés de publier en anglais pour être vraiment reconnus dans leur domaine, l’anglais est devenu la langue obligatoire, qu’on doit d’ailleurs certifier pour obtenir son master. »
« Pour les autres langues, comme il s’agit de formations ponctuelles et non pérennes, on embauche essentiellement des vacataires, en fonction des besoins, en se cantonnant à l’apprentissage de la langue. Les aspects culturels ayant tendance à passer à la trappe », regrette-t-elle.
La recherche : un eldorado difficilement atteignable
Une morosité encore accrue par la difficulté à participer à des travaux de recherche, pour la grande part d’enseignants du secondaire, voire du primaire, en poste dans le secteur.
D’abord, faute d’activité de recherche en langues là où ils officient. Ensuite, du fait de la difficulté à avoir une décharge d’enseignement. « Même si on se lance dans un doctorat, il faut attendre la première ou la deuxième année », note Jeanny Prat.
La crise sanitaire a enfoncé le clou

Le marasme, déjà ambiant depuis plusieurs années, s’est encore aggravé depuis le printemps dernier. Plus que dans toutes les autres disciplines, l’enseignement des langues a été plombé par le port du masque lors des cours menés en présentiel.
« Plus de mimiques faciales, moins de visibilité pour les émotions. En classe de langues, le masque ne facilite pas la communication », déplore Marie-Pascale Hamez, maîtresse de conférences en didactique du FLE à l’Université de Lille.
Par ailleurs, les mesures sanitaires et notamment la fermeture des frontières ont particulièrement impacté ces disciplines. « Les UFR de langues sont en général ceux qui envoient le plus d’étudiants en échanges, précise Georges Bê Duc. Ceux hors espace Schengen ont été stoppés dans les deux sens. Un exemple : notre département de chinois envoie chaque année environ 80 % de ses étudiants dans quatre universités partenaires en Chine. Pendant deux ans, aucun n’a pu partir, ce qui est bien sûr déprimant. »
Des enseignants globalement heureux… surtout quand titulaires
Pourtant, ce métier ils l’ont bien sûr choisi, et ils n’en changeraient pour rien au monde. Notamment les heureux titulaires d’un concours de la fonction publique, qui ne connaissent pas les incertitudes liées au renouvellement de leur contrat ni les fins de mois difficiles.
« Issue du second degré, sur le plan statutaire, je n’ai jamais rencontré de différences, déclare Jeanny Prat. Entre enseignants de langues étrangères différentes, on est tous solidaires. » Les E-C des UFR de langues, qui enseignent à la fois la langue et la culture, étant, sans surprise, les plus satisfaits.
« Nous avons des objets de recherche dans les secteurs les plus divers (linguistique, histoire, littérature etc.), note Georges Bê Duc. Les E-C de mon UFR travaillent avec des spécialistes les plus divers, en lettres, sciences humaines et sociales, histoire-géographie, etc. ». Pas de discipline « rare » pour ces profils, mais des objets de recherche toujours singuliers et passionnants !
*Native : personne qui est née dans le pays de la langue enseignée et dont c’est la langue maternelle.