“L’eau tiède ne marchera pas” : comment l’ESR doit miser sur le podcast
Comment faire des podcasts un outil d’influence pour les établissements du supérieur et de la recherche ? C’est à cette question que répond le livre blanc « Podcast, un outil d’influence » de Canévet & associés et Binge Audio. Il explique comment faire de ce canal de communication intime et immersif un moyen d’engager et de transmettre des savoirs.

Valorisation de la recherche, engagement des communautés, rayonnement institutionnel… Le podcast s’impose comme un outil d’influence dans l’enseignement supérieur et la recherche.
Usages, atouts et erreurs à éviter sont au cœur d’un livre blanc sur le sujet, co-écrit par l’agence de conseil en communication Canévet & associés et le diffuseur de podcast Binge Audio, paru le 25 mars. Une ressource qui s’inscrit dans la lignée d’un premier webinaire sur la stratégie à construire autour de la création de podcasts qui s’est tenu en février 2024.
Quels usages ?
« Le podcast est un média qui continue à croître, avec 172 millions de podcasts français téléchargés dans le monde rien qu’en janvier 2025. Il attire un public jeune, plutôt urbain et engagé : 60 % sont impliqués dans une association, 68 % sont sensibles aux causes environnementales, et 50 % ont moins de 35 ans », contextualise Manuel Canévet, dirigeant de Canévet & associés, lors d’un webinaire de présentation du livre blanc.

Pour plaire, il ne faut pas trop chercher à lisser les aspérités : « L’eau tiède ne marchera pas. La façon d’angler votre podcast sera déterminante », prévient-il.
La consommation de podcasts est essentiellement mobile et immersive et une majorité des écoutes se font dans les transports. « Cela implique une façon d’écouter plus intime. La voix a un rôle important et permet d’identifier un podcast. Ce format génère de l’engagement : si le premier épisode plaît, l’auditeur aura envie de continuer à en écouter d’autres », souligne Manuel Canévet.
Selon lui, le ratio entre investissement et retombées est important. « C’est un outil pour les sachants : il faut s’en servir pour partager votre expertise et mobiliser vos communautés, les alumni par exemple. »
Un outil stratégique pour gagner en influence
« Le podcast est encore sous-exploité dans l’enseignement supérieur et la recherche, même si beaucoup ont fleuri ces dernières années. Les universités et organismes nationaux de recherche manquent encore d’influence — on a pu le constater avec des épisodes récents politiques autour du budget », regrette Manuel Canévet.
L’ESR peut néanmoins compter sur une certaine reconnaissance de son expertise, qui est parfois sollicitée dans les médias ou par les politiques via des panels d’experts. Dès lors, le défi : « Comment connecte-t-on cette reconnaissance partielle à sa marque ? Le podcast est un vecteur de prise de parole pour les enseignants-chercheurs et une possibilité de toucher de nouveaux publics », ajoute le fondateur de Canévet et associés.
Des bonnes pratiques à cultiver
Joël Ronez, dirigeant et co-fondateur de Binge Audio, partage plusieurs conseils :
-
Réfléchir à l’utilité du podcast, à ce qu’il apporte au débat : « Il faut se poser la question de la valeur d’usage du contenu, capter l’attention avec des sujets qu’on ne retrouve pas dans les médias mainstream. »
-
Questionner les angles morts : « Le Serment d’Augusta de Sorbonne Université, par exemple, enquête sur la relation traitant-patient. Un regard extérieur est apporté par une autrice. »
-
Être pointu pour être accessible : Alors que l’auditeur dédie en moyenne 25 minutes à un podcast, il cherche à approfondir sa connaissance des sujets traités. « Il ne faut pas faire d’impasse. Plus on est pointu, et qu’on explique ce dont on parle, plus on est accessible. »
À ne pas faire !
Joël Ronez prévient qu’il faut éviter de :
-
Lancer beaucoup de petits podcasts isolés : « Mieux vaut concentrer les forces sur une seule offre éditoriale cohérente. »
- Enregistrer des conférences ou colloques : « Cela s’écoute très mal. Le podcast est écrit pour être lu. »
Enfin, il ne faut pas tomber dans le piège de faire un podcast qui ne parle qu’à soi. Albane Fily, directrice de production de Binge audio, estime : « Il vaut mieux être intéressant qu’intéressé et se mettre toujours du côté des auditeurs. »
Une stratégie de diffusion à anticiper
« Poser un contenu quelque part ne suffit pas à générer de l’écoute », alerte Joël Ronez. Il faut ainsi penser tôt à la distribution et aux canaux de communication : « Soit vous avez endroit identifié avec un volume suffisant d’abonnés (newsletter, YouTube…), soit vous pouvez travailler avec des médias pour plus de visibilité. »
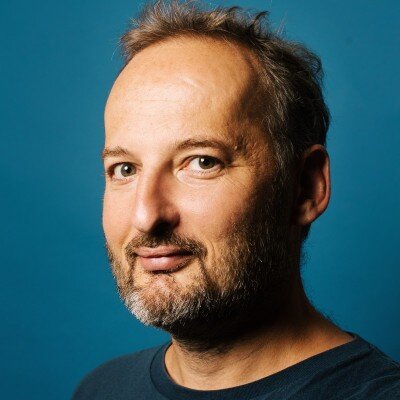
Techniquement, la distribution du podcast se fait par un flux RSS. « Il faut partager publiquement tous les contenus, même ceux à destination de l’interne. Soit vous avez votre propre RSS, soit vous utilisez un flux existant », ajoute le dirigeant de Binge Audio.
Autre conseil : mobiliser l’interne pour mieux toucher en externe. « Le bouche-à-oreille est le meilleur moyen pour faire connaître un podcast. » Une soirée d’écoute, comme l’a fait Sorbonne Université avec le Serment d’Augusta, est un bon début. En outre, « plus vous êtes récurrent, mieux c’est : la radio est un média d’habitude », rappelle Joël Ronez.
Et pour une audience internationale ? « Il vaut mieux enregistrer le podcast dans la langue cible. Pour certains formats narratifs, il est possible de faire une version traduite avec une voix générée par l’IA, mais cela reste une expérience un peu dégradée », expose Joël Ronez.
Financement : un budget à établir selon le format et non la durée
Le budget d’un podcast ne dépend pas de sa durée, mais de son format. « Sur du talk, il faut compter entre 4 000 et 6 000 euros l’épisode, explique Joël Ronez. Cela nécessite de faire venir les intervenants dans un studio, que ce soit pour 30 ou 45 minutes de podcast, cela reviendra au même prix. Un reportage, en revanche implique de se déplacer, de suivre un événement, etc. Cela tournera autour de 10 000 euros. » Quant à la fiction, les budgets peuvent s’envoler : au-delà de 20 000 euros hors taxes par épisode.
À ce coût de production, s’ajoute celui de la promotion, souvent négligée. « Pour 100 euros investis dans la production, il faudrait idéalement en mettre 100 dans la diffusion. En réalité, les gens mettent rarement plus de 50 », regrette Joël Ronez.
Enfin, pour ceux qui souhaiteraient se lancer, Albane Fily rappelle : « Il faut en moyenne trois mois entre le “go” et la diffusion du premier épisode. »
- Consulter le livre blanc « Podcast, un outil d’influence » de Canévet & associés et Binge audio.